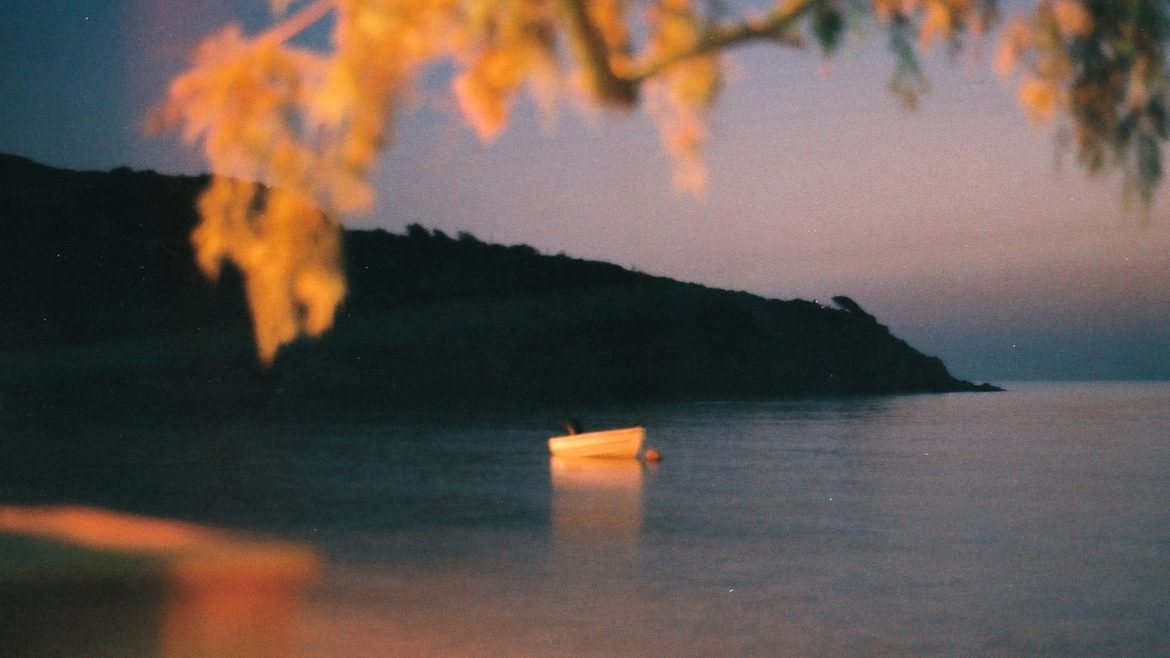8 outils terminologiques, pour comprendre la santé mentale des racisés
En quoi les processus de racialisation régissent, structurent, impactent notre santé mentale ? Pourquoi certains espaces ; physiques, psychiques, symboliques ; sont-ils psychologiquement infranchissables ou difficilement accessibles aux personnes racisées négativement ?
Nous nous sommes interrogés sur ces questions lors d’un échange en toute simplicité lors de notre évènement « La santé mentale des racisés : entre expérience et prospection » organisé par le Cabinet Madi Said.
Pour aller plus loin, voici 8 outils terminologiques pour comprendre la santé mentale des racisés.

Colorful Hands 2:3 – Newberg, Oregon/ Par les étudiants de l’université de George Fox A. Wombacher, J. Mar, S. Ratcliff et B. Cahoon.
Cet article a pour objectif de permettre d’apposer des mots sur des phénomènes vécus par des personnes souffrant d’une pression psychologique exacerbée et continue en raison de leur couleur de peau et/ou de leur culture. Les terminologies exposées ont leur propre complexité dans le registre des sciences sociales et psychologiques, ils évoluent également à travers le temps et ont pu parfois désigner des réalités différentes en fonction de leurs auteurs et des contextes dans lesquels ils ont été utilisés. Nous avons essayé d’être le plus fidèle à leur acceptation contemporaine. Lorsque différentes acceptations existent, nous avons retenu celles caractérisées par leur dimension psychologique afin de pouvoir permettre aux personnes vivant ou ayant vécu des violences psychologiques en raison de leur racisation, à comprendre certains phénomènes qu’ils vivent aujourd’hui.
Votre santé mentale est importante et impacte vos perceptions et vos capacités d’action et de réflexion, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute si vous en ressentez le besoin.
1 – Race.
Moyen de catégorisation selon lequel les êtres humains se différencient sur des caractéristiques dîtes raciales telles que la couleur de peau ou l’espace territorial d’origine ou leur culture, impliquant généralement l’idée d’une supériorité naturelle d’une race par rapport aux autres (racisme). Elle n’a pas de réalité biologique, mais implique des réalités sociales de discrimination et de violences psychologiques et physiques (voir racialisation).
Processus mental en jeu :
Minorisation, déshumanisation, altérisation et silenciation des personnes victimes de cette idée. Les motivations à l’origine de la notion de race impactent directement la santé mentale des racisés car elles induisent une différenciation de traitement favorisant une « race » sur les autres. Voir Racialisation.
2 – Racialisation.
Processus d’attribution et de catégorisation par lequel un groupe de personnes est défini par sa race, incluant non exclusivement des caractéristiques dîtes raciales telles que le phénotype, la biologie, des capacités cognitives supposées congénitales. Mais aussi culturelles telles que l’identité, l’éducation, le langage, le mode de vie, les valeurs.
Elle engendre un ensemble de comportements et de politiques exerçant une pression psychologique importante et réduisant l’horizon des possibles des personnes touchées.
Processus mental en jeu :
La race est une idée, une théorie, la racialisation, son aspect pratique en tant que processus ancrant cette idée en outils complexes et intégratifs des structures et institutions devenant des moyens d’oppression et d’exploitation physiques et psychiques des racisés. C’est le moyen par lequel l’idée de race et son parti pris idéologique deviennent des instruments réels d’action et de différenciation au sein de la société.
3 – Racisé.
Personne définie par l’idée de race. De manière générale, on parle des personnes victimes des idées raciales, des populations déshumanisées et discriminées sur la base d’idées et d’assertions racistes, et donc des personnes pâtissant d’un système inégalitaire basé sur l’idée de race, soit les personnes non-blanches. On parle aussi de personne « racialisée ».
Cependant, la racialisation engendre un traitement inégal sur la base d’une supposée réalité biologique, il existerait donc des racisés positifs (personnes blanches) et des racisés négatifs (personnes non blanches incluant donc les personnes noires, métisses, arabes, asiatiques, sud américaines, indigènes etc…)
Processus mental en jeu :
Voir Charge raciale.

4 – Santé mentale.
La santé mentale représente à la fois l’absence de pathologie mentale mais aussi un état de bien être physique, social, cognitif et mental.
Processus mental en jeu :
Les personnes racisées sont davantage touchées par des violences médicales (exemple du syndrome méditerranéen, violences obstétricales/gynécologiques, pathologisation de certains comportements ou processus mentaux sur la base de stéréotypes raciaux). Mais aussi par le manque de représentativité au sein des équipes d’accompagnement médical ou psychologique, ce qui engendre une prise en charge moins importante de ces personnes et une errance médicale exacerbée.
5 – Charge raciale.
Pression psychologique et charge mentale spécifique aux personnes dîtes racisées comprenant un ensemble de mécanismes de défense préventifs et continus dans des espaces jugés hostiles ou menaçants afin de protéger son intégrité physique et mentale. Par exemple, elle inclue la silenciation de ses vécus, ressentis dans ces espaces, une tension entre conformité aux attentes d’une majorité blanche pour ne pas souffrir de violence (symbolique, mentale, physique), une pression à devoir justifier, démanteler et déconstruire des préjugés ou actions racistes, tout en anticipant continuellement des situations discriminatoires pour s’en protéger. Ce terme a été utilisé et théorisé par la chercheuse française Maboula Soumahoro.
Processus mental en jeu :
La charge raciale attaque directement la santé mentale des racisés car elle créé une situation de défense mentale continuelle pour pouvoir survivre dans des environnements chargés de violence protéiformes et intériorisés.
6 – Métacolonialisme.
Colonisation des espaces psychiques et symboliques tels que la psychologie, le temps ou le sens, concomitant et persistant après l’esclavage, le colonialisme classique et le néocolonialisme.
Ce terme est théorisé et utilisé par Hussein Bulhan, chercheur et fondateur de l’université Frantz Fanon en Somalie.
Il s’agit d’une colonisation des pensées et des psychés. Les recherches de Bulhan s’inspirent des travaux de Frantz Fanon, psychiatre antillais qui parle de l’aliénation des indigènes voulant se « déracialiser » en adoptant les codes, valeurs et modes de pensée de l’oppresseur pour ne pas être assimilés à une race inférieure, ce en s’éloignant alors de sa culture d’origine et en effaçant son système de référence, cible de la domination.
Processus mental en jeu :
Le métacolonialisme illustre l’intériorisation d’une idéologie capitaliste et coloniale menant à une aliénation culturelle et psychologique. Aussi, ce concept a le mérite de souligner les effets contemporains coloniaux d’entités invisibilisées puisqu’elles concernent des notions et espaces relativement abstraits tels que le temps, le sens, la psychologie…

7 – PTSS.
Le Post Traumatic Slave Syndrom – Syndrome Post Traumatique de l’esclavage – désigne l’ensemble des traumatismes transgénérationnels vécus par les personnes afro-américaines depuis l’esclavage à nos jours. Il est le fruit des recherches de la psychologue chercheuse américaine Joy de Gruy qui explique les effets contemporains de l’exploitation du travail forcé et du commerce des personnes noires durant l’esclavage et leur retombées directes aujourd’hui auprès des descendants afro-américains. Par conséquent, le PTSS débouche sur l’évitement de certains espaces, d’activités et de situations pouvant réactiver ou rappeler l’ensemble des traumatismes vécus lors de l’esclavage (ne pas se faire remarquer pour éviter des représailles physiques ou psychologiques, dévaloriser ses enfants publiquement pour les protéger d’atrocités ou d’exploitation physiques par d’autres, carences abyssales d’estime de soi, perspectives autodestructrices, défiances du corps médical ou des autorités institutionnelles etc…).
Processus mental en jeu :
Comprendre les effets intergénérationnels d’une violence ayant été vécue par les esclaves, ici la population noire américaine. Il s’agit de comprendre ici la réactivation de traumatismes qui continuent de se manifester à ce jour et qui pèsent collectivement sur les descendants d’esclaves.
8 – Colonialité.
Manières de penser, sentir et vivre associée à une domination globale européenne.
Processus mental en jeu :
Comprendre l’aliénation par l’intégration de la colonialité dans les relations de pouvoir qui pérennisent la domination culturelle et les institutions coloniales. De plus, la colonialité s’intègre également dans des formes de savoirs particuliers, de manières d’être à soi et au monde. Elle participe de l’imposition de standards homogènes et hégémoniques, niant les caractères spécifiques et la pleine possibilité d’épanouissement des personnes ne correspondant pas à ces standards.
*
Alors, que pouvons nous retenir de tout ca ?
Frantz Fanon était psychiatre et a exercé en Algérie française, Hussein Bulhan, docteur en psychologie diplômé des universités de Harvard, Boston et Wesleyan, travaille actuellement en Somalie, Joy de Gruy psychologue et chercheuse, est afro-américaine et a conduit ses recherches entre les Etats Unis et le continent Africain… Le fruit de leurs recherches est intéressant car il émane de personnes situées, racisées de formation médicale et/ou psychologique.
Ainsi, ces outils permettent de mieux comprendre comment l’histoire et les contextes dont nous sommes issus, continuent de forger nos histoires et nos psychés.
L’un des premiers processus de guérison pour pour aller mieux mentalement, est de se permettre de reconnaître que l’on souffre et de quoi on peut souffrir. Mettre des mots sur ces réalités permet d’asseoir leur matérialité et de comprendre que ces expériences existent et sont reconnues par d’autres. Nous espérons que ce modeste article vous permettra de mieux comprendre certaines choses que vous ou vos proches pouvez vivre.
Votre santé mentale est importante, il est nécessaire de la soigner, de la protéger et de la préserver.
Si vous en ressentez le besoin, un thérapeute peut vous aider à y voir plus clair.
Aussi, si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à vous faire accompagner par le Cabinet Madi Said ou par tout autre professionnel à même de vous aider à réaliser un travail psychologique, pour vous aider à aller mieux.
Vous avez aimé cet article ? N’hésitez pas à le partager !